Création autonome et droitd’auteur : la prévalencede la création humaine
Contexte :
En mai 2019, une demande d’enregistrement a été déposée auprès du Copyright Office au titre d’une image générée par un système d’intelligence artificielle, et désignant celui-ci comme unique « auteur » de l’œuvre intitulée A Recent Entrance to Paradise. Le mandataire s’adjugeait la seule qualité de déposant de l’image en question.
L’Office s’est opposé à ce dépôt, en se fondant sur l’absence d’intervention créative d’un être humain et a rejeté l’assimilation de la machine à un salarié au titre du « work-made-for-hire ».
Cette exception tirée du « Copyright Act of 1976 » permet à un employeur ou à un mandant de bénéficier de la titularité des droits patrimoniaux sur une œuvre en l’absence de cession écrite.
En droit français, une telle exception n’est pas admise dès lors qu’aux termes des articles L. 111-1 et L. 113-1 , seul le créateur d’une œuvre originale est titulaire de droits. L’employeur est donc contraint de se faire céder les droits au moyen notamment d’une clause dans le contrat de travail à l’exception des logiciels créés par un salarié, des œuvres dites journalistiques ou collectives.
Saisi en justice, le tribunal de première instance du District de Columbia a, le 3 novembre 2023, jugé que la condition d’« auteur humain » était indérogeable et que l’argument du « work-made-for-hire » ne pouvait ainsi prospérer sans un auteur humain initial.
Le 18 mars dernier, la Cour d’appel a confirmé cette analyse.
Problématique juridique et solution retenue :
La Cour d’appel a eu à trancher l’épineuse question de la qualification d’auteur à la lumière du Copyright Act et à se prononcer sur une éventuelle protection conférée par celui-ci à une entité non humaine.
Deux axes de réflexion se sont ici opposés :
D’une part, l’argument selon lequel la créativité, entendue comme émergence d’une œuvre singulière, pourrait être déconnectée de l’auteur humain traditionnel ;
D’autre part, l’argument de la préservation du lien personnel, moral et économique entre l’auteur et son œuvre, socle du régime des droits d’auteur est avancé.
Solution retenue :
La cour d’appel, dans une décision du 18 mars 2025, a opté pour une lecture littérale et téléologique du Copyright Act : le terme « author » renvoie exclusivement à un être humain, dont l’intervention créative reste la condition nécessaire à la la protection conférée par le copyright.
La vision française du droit d’auteur :
Cette décision a pour mérite de poser un cadre quant à la protection des œuvres créées par IA.
En droit Français, l’on rappellera que l’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. »
La conception personnaliste du droit d’auteur français offre une place prépondérante à l’auteur personne physique.
Le droit français garde cette image d’Épinal de l’auteur travaillant seul dans son atelier.
Si la loi ne définit pas explicitement l’auteur, d’autres dispositions du CPI font une référence directe à la notion d’auteur en tant que « personne physique » à l’instar des articles relatifs à l’œuvre de collaboration, à l’œuvre audiovisuelle et à l’œuvre radiophonique.
Que faut-il en retenir ? :
S’il est théoriquement concevable d’étendre la définition de l’originalité aux créations issues de l’intelligence artificielle à l’instar de l’adaptation opérée pour les logiciels. Une telle extension supposerait qu’une décision reconnaisse qu’une œuvre générée à l’aide d’un système d’intelligence artificielle témoigne d’un « apport intellectuel » suffisant de la part de son utilisateur.[1]
Une extension de cette nature ne saurait pour autant être préconisée sur le plan législatif. Selon certains auteurs, la distinction fondamentale réside dans la persistance, s’agissant des logiciels, d’un créateur humain dont l’apport intellectuel personnalisé demeure identifiable, préservant ainsi l’essence même du droit d’auteur.
Il est important de préciser que si cette décision américaine dénie la qualité d’auteur à une entité non humaine, d’autres pays comme l’Afrique du Sud ont pu admettre une protection. Une décision de l’office des brevets sud-africaine, le 29 juillet 2021 concernant un brevet pour un conteneur alimentaire conçu par DABUS, une IA développée, comme dans l’arrêt d’espèce, par le chercheur Stephen Thaler.
Les conséquences pour l’avenir de la propriété intellectuelle :
Les systèmes d’IA présentent différents degrés d’autonomie. Certains sont capables de de formaliser de manière indépendante (en s’appuyant sur des données potentiellement protégées, bien que cela ouvre un autre débat), tandis que d’autres « assistent » l’humain dans le processus créatif, fonctionnant comme des outils à son service, à l’image d’un logiciel de graphisme, de composition musicale…
Cette distinction s’est révélée centrale dans l’affaire opposant le U.S. Copyright Office à Jason M. Allen, auteur d’une œuvre intitulée Théâtre D’opéra Spatial. Ce dernier avait généré cette image à l’aide du système Midjourney, en expérimentant plus de 600 prompts, puis en la retouchant manuellement via Adobe Photoshop.
Il a ensuite sollicité une protection par droit d’auteur sur l’ensemble de l’œuvre. L’Office a cependant proposé de limiter la protection aux seules modifications humaines identifiables dans la continuité de la logique employée par la cour d’appel dans la présente décision.
Le demandeur a toutefois refusé cette approche, conduisant au rejet pur et simple de la demande
Cette interprétation du système d’intelligence artificielle en tant qu’outil créatif pourrait, à première vue, présenter un certain intérêt. En effet, lorsqu’un artiste formule plusieurs centaines d’instructions (prompts), l’œuvre générée ne porte-t-elle pas, dans une certaine mesure, l’empreinte de sa pensée créative ?
Une telle approche pourrait s’entendre pour peu que les sources exploitées par le système d’intelligence artificielle soient naturellement licites et respectent les préconisations du RIA ACT.
Toutefois, cette approche soulève des difficultés substantielles : dans le cas d’une création assistée par l’IA, est-il toujours possible d’établir une distinction claire entre l’apport humain et la contribution algorithmique ?
Tantôt cette dissociation s’avère réalisable, tantôt elle se heurte à une intrication indissociable, conduisant à s’interroger sur l’application éventuelle de la théorie du principal et de l’accessoire.
En réalité, une partie de la doctrine considère que l’IA ne saurait être appréciée comme un simple outil au sens traditionnel, dans la mesure où elle introduit une forme d’autonomie dans le processus créatif.
Une appréciation en faveur de la reconnaissance de droits sur une oeuvre générée par IA reste encore assez isolée et nécessitera l’appréciation du juge qui, à n’en pas douter privilégiera la condition de création humaine à toute qualification d’oeuvre de l’esprit. To be continued..
[1] Assemblée plénière du 7 mars 1986 (Pachot), l’originalité d’un logiciel peut être appréciée comme un « effort personnalisé dépassant la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante », marquant ainsi « l’apport intellectuel de l’auteur ».
Maître Jonathan Elkaim – Avocat
Alessandro Tummillo – Juriste
Envie d’en savoir plus ? Suivez-nous sur LinkedIn pour ne rien manquer de l’actualité du droit des nouvelles technologies !

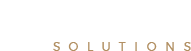
Laisser un commentaire